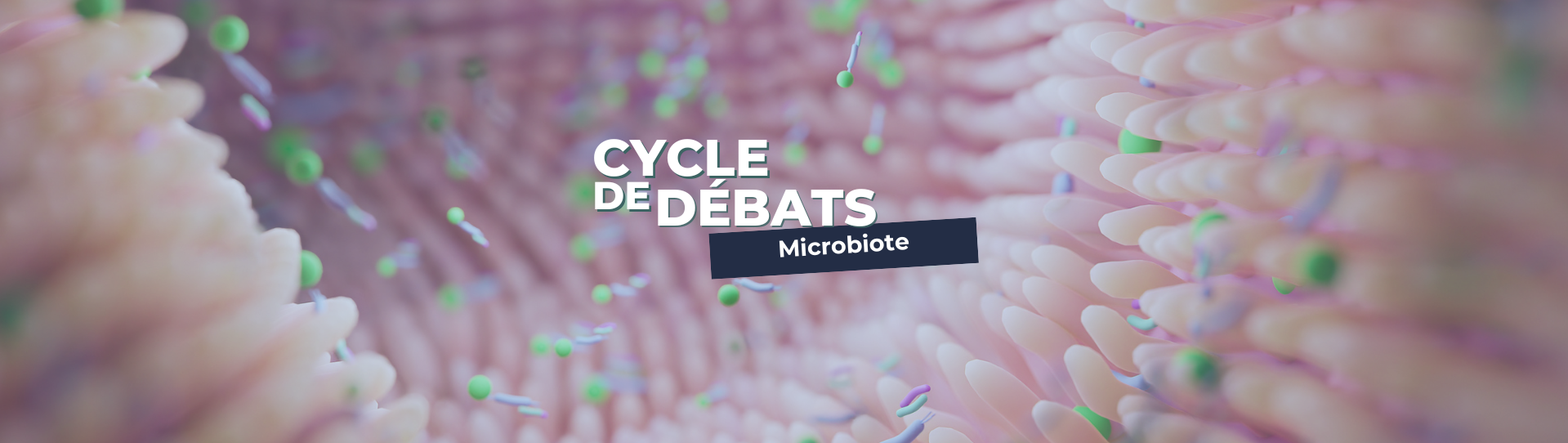
Débat inaugural : Le microbiote, un monde caché essentiel à notre santé
CYCLE JE ME VACCINE POUR MOI & POUR LES AUTRES
Saviez-vous que notre corps abrite des milliards de micro-organismes qui interagissent avec nous au quotidien ? Que ce soit dans notre intestin, sur notre peau, dans notre bouche ou encore nos voies respiratoires et uro-génitales, ces communautés invisibles sont essentielles à notre bien-être. Mais quand cet équilibre se brise, c’est tout notre organisme qui en pâtit : maladies inflammatoires, troubles métaboliques, infections, et même certaines pathologies neuropsychiatriques. Comment préserver cet équilibre fragile ? Quels sont les impacts de notre alimentation, de notre mode de vie ou de l’environnement sur ces milliards d’hôtes qui nous habitent ? Et comment la science tente-t-elle d’exploiter leur pouvoir pour mieux soigner certaines maladies ?
Ce débat inaugural sur la thématique « Santé et microbes : l’alliance invisible » aborde les thématiques suivantes :
- Du microbe au microbiote
- La diversité des microbiotes
CE QU’IL FAUT RETENIR DU DÉBAT :
Intervention du Dr Gwenaelle Locher :
Elle a illustré avec des exemples concrets d’émergences infectieuses les quatre rencontres cruciales qui ont marqué la coévolution entre l’homme et les microbes :
↪︎ Le néolithique : le passage à l’élevage et la sédentarisation ont accru les contacts avec le bétail et favorisé les regroupements humains, modifiant l’écosystème microbien (#tuberculose)
↪︎ Le choc Eurasie (> 1er siècle) : le développement du commerce et les conquêtes ont unifié les microbiotes d’Europe et d’Asie (#peste)
↪︎ Le choc post-15e siècle : la découverte du Nouveau Monde et le commerce triangulaire, impliquant l’Afrique, ont entraîné des échanges microbiens sans précédent entre les continents (#syphilis)
↪︎ L’anthropocène (19e siècle – aujourd’hui) : l’industrialisation et la mondialisation ont uniformisé, et accéléré les rencontres entre hommes et microbes, avec des conséquences importantes sur la propagation des maladies infectieuses (#pandémies)
Intervention du Pr Vincent Jarlier :
↪︎ une vision centrée sur les germes responsables de maladies infectieuses : la microbiologie clinique qui considère nos flores commensales (= avec lesquelles nous vivons en symbiose) comme une source potentielle de maladies : soit parce que leur équilibre est perturbé par un évènement extérieur, soit parce que certains germes commensaux quittant leur niche deviennent pathogènes, soit par leur évolution vers la multirésistance 🧫
↪︎ une approche holistique considérant l’ensemble des micro-organismes (bactéries, champignons…) d’un environnement spécifique (intestinal, cutané…) comme un écosystème, le microbiote, analysé grâce aux techniques de séquençage génétique (métagénomique) 🧬
Ce changement de perspective, impulsé par les progrès techniques et des scientifiques non-infectiologues, permet d’explorer le rôle du microbiote dans des pathologies non infectieuses et d’identifier des signatures microbiennes spécifiques associées.
Intervention du Dr Alexis Mosca :
↪︎ Comment le microbiote du nouveau-né se construit dès le « big bang » de la naissance, influencé par le mode d’accouchement (voie basse vs césarienne), la transmission des bactéries de l’environnement et des parents, l’alimentation (allaitement maternel vs biberon) et les traitements ;
↪︎ L’importance du codéveloppement du microbiote intestinal avec les systèmes immunitaire et métabolique du bébé, et l’impact de ce dialogue permanent sur sa santé future ;
↪︎ L’appauvrissement du microbiote au fil des générations, lié à la diminution de la biodiversité bactérienne et à l’amélioration des conditions d’hygiène. Si cette dernière a permis de réduire considérablement la mortalité infantile, elle augmente paradoxalement le risque de maladies inflammatoires chroniques (asthme, maladie de Crohn, obésité…).
Intervention de Joël Doré :
↪︎ L’état actuel des connaissances sur le microbiote digestif : fonctions essentielles, facteurs qui l’influencent, variabilité d’un individu à l’autre, identification de grandes écologies bactériennes, dont certaines sont associées à des pathologies, et possibilité d’identifier des signatures prédictives de maladies.
↪︎ Le concept clé de « l’humain microbien », les dérèglements du microbiote ont des répercussions directes sur notre santé, impactant la perméabilité digestive, le métabolisme, et bien plus encore.
↪︎ Les avancées du projet @le French Gut, une collaboration @MetaGenoPolis-InRAE @APHP @INSERM @CEA @Institut Pasteur, qui vise à caractériser le microbiote digestif de 100 000 sujets sains et malades sur la durée. Ce projet ambitieux permettra de documenter la variabilité du microbiote, d’établir des liens entre le microbiote, l’environnement, les habitudes de vie, les facteurs de risque de maladies, et les signatures microbiennes pour aider à développer le diagnostic, la prévention et la thérapeutique de demain.
↪︎ L’importance de cette recherche à l’échelle nationale et internationale. La science du microbiote est un enjeu majeur de santé publique, elle s’inscrit dans l’initiative PEPR (Programme et équipements prioritaires de recherche) 2030 et se structure au niveau européen et mondial.
Intervention du Pr Brigitte Dreno :
↪︎ Comment le microbiote cutané se met en place à la naissance, influencé par le mode d’accouchement (voie basse vs césarienne).
↪︎ L’évolution rapide du microbiote cutané, avec des différences apparaissant dès l’âge de 3 mois selon les zones de la peau (sèches, grasses, humides) et un microbiote cutané infantile qui reste distinct de celui de l’adulte jusqu’à la puberté.
↪︎ L’impact de la puberté sur le microbiote cutané : sous l’influence des hormones, la peau devient plus grasse, sélectionnant des microorganismes adaptés qui persistent à l’âge adulte.
↪︎ Les modifications du microbiote cutané au cours du vieillissement, liées aux changements physiologiques de la peau (affaiblissement du système immunitaire, diminution du renouvellement cellulaire et de la production de sueur, modification de la production de sébum).
↪︎ Les déséquilibres du microbiote cutanés associés à certaines pathologies.
Intervention du Dr Jean-marc Bohbot :
↪︎ L’importance du microbiote vaginal, impactant potentiellement la qualité des spermatozoïdes ᯡ lors de la conception, et « première fenêtre sur le monde extérieur » lors de l’accouchement.
↪︎ Sa fluctuation au cours de la vie en fonction de l’imprégnation œstrogénique : le microbiote vaginal est hormonodépendant, et est donc différent chez la petite fille 👧, la femme adulte 👩 ou la femme ménopausée 🧓. Dynamique, il évolue avec le cycle menstruel, la grossesse, l’accouchement et la ménopause, tout en étant résilient, capable de retrouver son équilibre.
↪︎ Comment le microbiote vaginal, simple à analyser du fait de son accessibilité, permet de comprendre son rôle dans les infections courantes (mycoses, infections urinaires) .
↪︎ Les facteurs de dysbiose vaginale : tout ce qui contribue à diminuer le taux d’œstrogènes (post-partum, pilules insuffisamment dosées en œstrogènes, ménopause, le tabac !), les antibiotiques, l’usage intempestif de produits d’hygiène inadaptés
↪︎ Les connexions du microbiote vaginal avec les microbiotes intestinal (via le rectum et l’estrobolome, communauté de bactéries intestinales modifiant la concentration en œstrogènes) et vésical, expliquant le rôle d’un microbiote vaginal déséquilibré dans les infections urinaires récidivantes, d’où l’importance d’une approche globale de la santé de la femme, incluant l’environnement, l’alimentation et l’exercice physique.
Intervention du Pr Martine Bonnaure-Mallet :
Elle a notamment expliqué :
↪︎ Comment le microbiote buccal s’installe à la naissance, avec une flore variant selon le mode d’accouchement. L’arrivée des premières dents, vers 6 mois, puis des dents définitives, modifie profondément cet écosystème en offrant de nouvelles surfaces de colonisation.
↪︎ Comment la cavité buccale, véritable porte d’entrée de l’organisme, abrite une flore diversifiée (700 espèces bactériennes !) influencée par l’alimentation 🍡🧋, l’hygiène et le tabac 🚬. Maintenir son équilibre est essentiel pour prévenir les maladies parodontales (= maladies des tissus de soutien des dents : caries, gingivites, parodontites).
↪︎ L’importance d’une hygiène bucco-dentaire rigoureuse (brossage matin et soir + brossettes interdentaires à partir de 35 ans) pour éliminer la plaque dentaire et éviter la prolifération de bactéries pathogènes. Dentiste 1 fois par an.
↪︎ La raison de l’impact néfaste d’une consommation excessive de sucre 🍬🍭. Le sucre acidifie la bouche (pH 3 !), favorisant la prolifération de bactéries cariogènes et la formation de caries (après un bonbon, le PH mets 20 mn à se normaliser, donc 1 bonbon ok mais pas plus 😉). Le brossage après chaque consommation de sucre permet de rétablir un pH neutre (7) et de protéger l’émail dentaire.
↪︎ Le lien entre les maladies parodontales et des pathologies générales comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. L’inflammation buccale peut aggraver ces maladies, soulignant l’importance d’une prise en charge globale.
↪︎ Le rôle bénéfique des bactéries buccales (protection, production de vitamines, éducation du système immunitaire) tant que la dysbiose ne s’installe pas.
La Fondation de l’Académie de Médecine tient à remercier les centaines de personnes qui se sont connectées pour suivre le débat en ligne. Rien n’aurait été possible sans ses intervenants, ses mécènes et ses partenaires.
dans les projets
de la Fondation de l’Académie de Médecine
L’adresse mail récoltée est uniquement utilisée pour vous tenir informés de nos actualités et nos actions. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en utilisant le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.